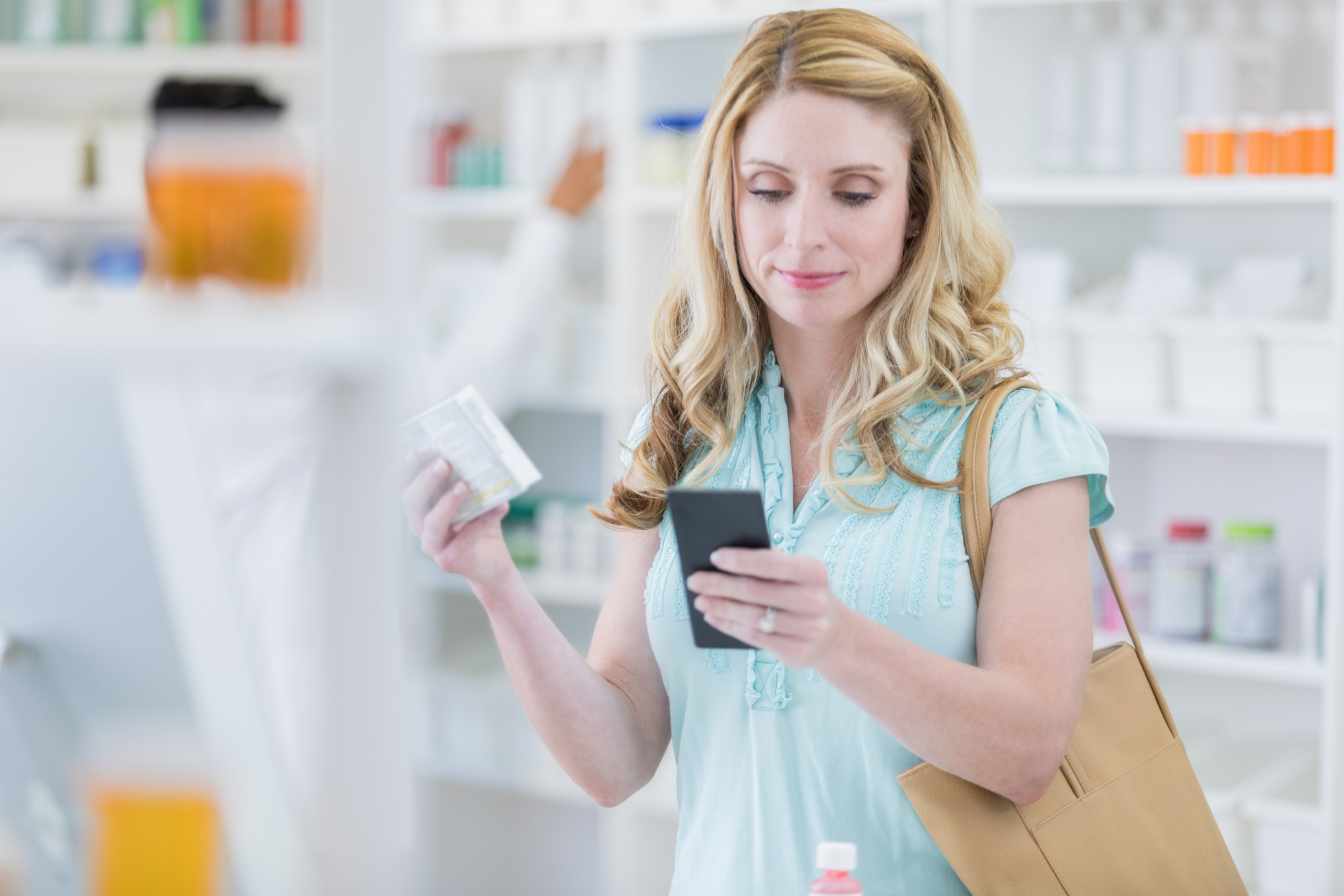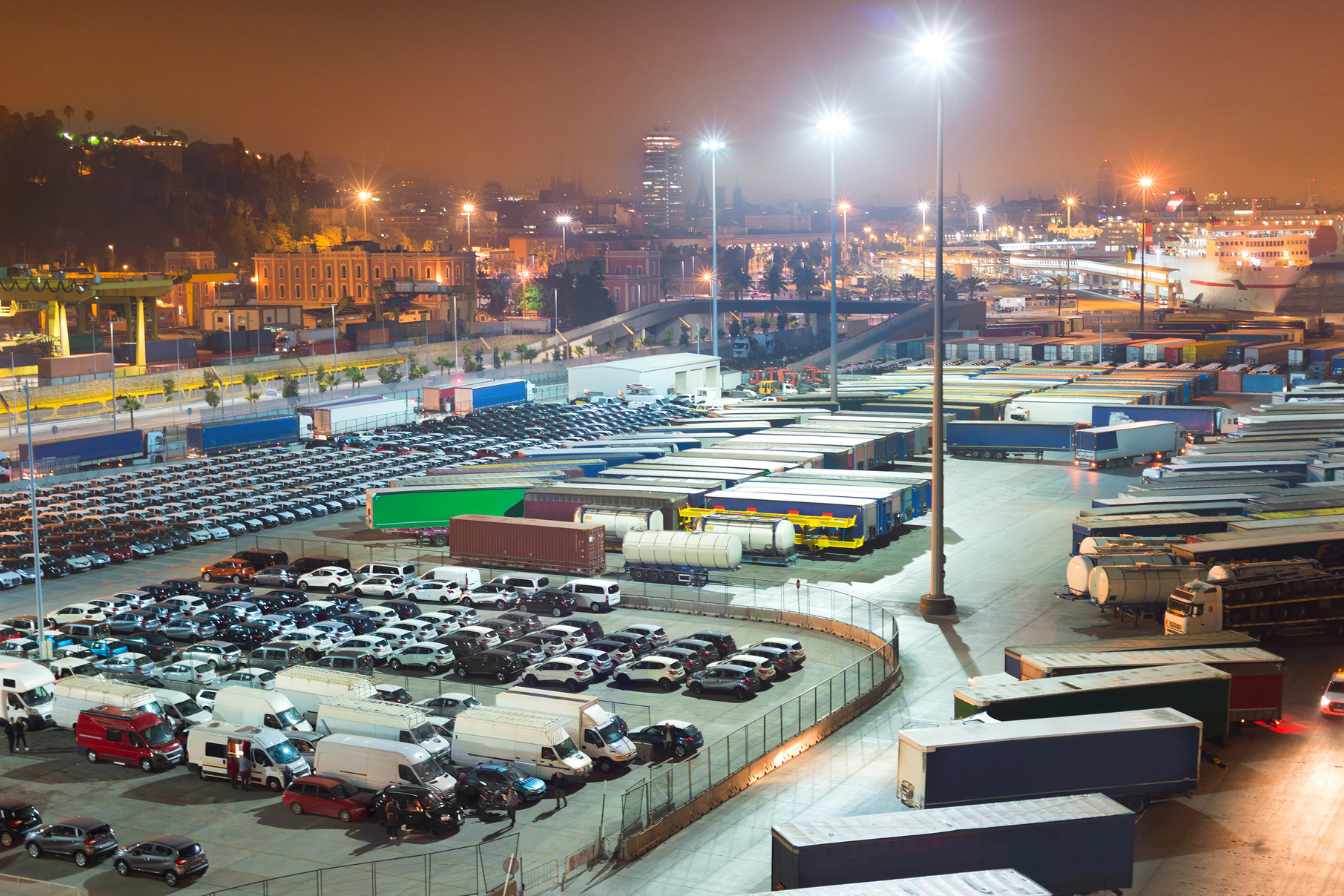Supr Agency : Agence Relations Presse et Influence à Paris – suPR!
Et nous sommes fiers de devenir .becomingwithsupr!
Créer, connecter et amplifier vos messages pour engager la conversation avec vos publics.
Conseil
Positionnement de marque / entreprises, stratégie d’influence, cartographie des influenceurs, lancement & innovation, mediatraining, veille & études
Relations médias
Relations médias corporate & consumer, influenceurs & bloggeurs, relations publiques communication de crise, eReputation
Content
Conception de ligne éditoriale, rédaction d’avis d’expert / tribunes / cas client / dispositifs de communication (messages clés…), community management
Growth hacking
Se faire connaitre auprès de ses prospects, acquisition de crédibilité; identification et mise en place de partenariats, accroître sa visibilité.
Events
Conventions, team buildings, soirées de lancement, kick off, voyages incentives en France et à l’International, lancement de produit, Think Tank
Influence
Recommandation stratégiques d’influence & contenus créatifs, activation de profils influenceurs pertinents, mise en place de collaboration, mesure de la performance des campagnes.